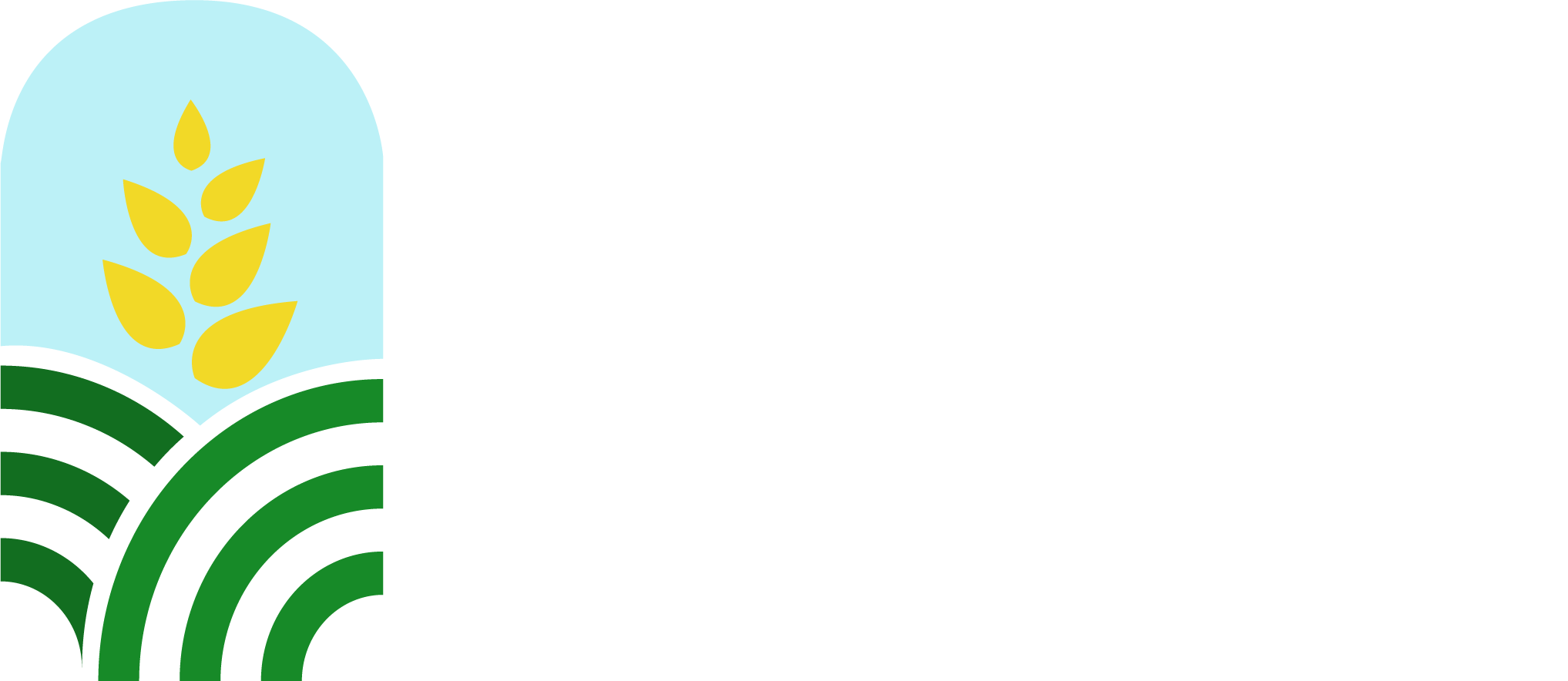Le stockage de carbone dans les sols agricoles : un levier clé pour l’agriculture durable
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, le stockage de carbone dans les sols agricoles s’impose comme une solution prometteuse. Longtemps sous-estimé, le rôle du sol comme puits de carbone suscite de plus en plus d’intérêt dans les milieux scientifiques, institutionnels et agricoles. Cette technique, aussi appelée séquestration du carbone, repose sur l’augmentation de la matière organique dans les sols, contribuant à la fois à la fertilité, à la résilience des écosystèmes et à l’atténuation du changement climatique.
Dans cet article, nous détaillons les pratiques agricoles favorisant le stockage du carbone, les bénéfices multiples pour l’agriculture durable, et comment cette approche peut s’inscrire dans les stratégies de transition agroécologique.
Comprendre le rôle du sol dans le cycle du carbone
Le sol est un réservoir naturel de carbone. Il contient trois fois plus de carbone que l’atmosphère. Ce carbone est stocké sous forme de matière organique, issue des résidus végétaux, racines, microorganismes ou amendements organiques.
Ce processus de séquestration peut être naturel, mais il peut également être renforcé par des pratiques agricoles adaptées. Lorsqu’on parle de stockage de carbone dans les sols agricoles, on fait référence à l’augmentation durable de cette matière organique, minimisant les émissions de CO2 et maximisant l’absorption.
Pratiques agricoles favorisant le stockage de carbone
Plusieurs techniques agricoles permettent d’améliorer la captation et la rétention du carbone dans les sols. Ces pratiques sont au cœur de l’agroécologie et de la conservation des sols :
- Réduction du travail du sol : Le non-labour ou le semi-labour limite la perturbation du sol, réduisant ainsi la minéralisation de la matière organique. Cela permet une meilleure stabilisation du carbone.
- Rotations culturales et diversification des cultures : Alterner les cultures sur une même parcelle favorise une meilleure structure du sol et enrichit la biomasse souterraine, essentielle au stockage du carbone.
- Implantation de cultures intermédiaires : Les engrais verts et couverts végétaux captent du CO2 atmosphérique via la photosynthèse et restituent de la matière organique au sol une fois détruits.
- Apport de matières organiques : L’utilisation de compost, fumier, digestat de méthanisation ou résidus de culture permet d’enrichir significativement les sols en carbone organique.
- Agroforesterie : Associer des arbres aux cultures ou aux pâturages augmente la biomasse aérienne et souterraine, tout en protégeant les sols de l’érosion. Cette pratique booste le stockage de carbone à long terme.
- Pâturage tournant et gestion durable des prairies : En élevage, une gestion raisonnée des pâturages permet une meilleure séquestration du carbone grâce à une couverture végétale constante et un enracinement profond.
Les bénéfices environnementaux du stockage de carbone en agriculture
Au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les sols agricoles présente de nombreux avantages environnementaux. Il contribue ainsi à la durabilité des exploitations et à la résilience des territoires ruraux :
- Limitation de l’érosion et amélioration de la structure du sol : Les sols riches en matière organique sont plus stables et retiennent davantage les particules fines, réduisant le ruissellement et la perte de fertilité.
- Meilleure infiltration et rétention de l’eau : Un sol vivant agit comme une éponge naturelle. Cela est particulièrement utile en période de sécheresse.
- Réduction des intrants chimiques : Un sol plus fertile nécessite moins d’engrais de synthèse. Cela réduit la pollution des nappes phréatiques et les émissions indirectes liées à la fabrication d’engrais azotés.
- Augmentation de la biodiversité microbienne : Les micro-organismes du sol jouent un rôle central dans le cycle des nutriments et la santé des plantes.
Avantages économiques pour les agriculteurs
L’augmentation du carbone organique dans les sols n’est pas uniquement bénéfique pour l’environnement. Elle peut également représenter un gain économique significatif à moyen et long terme :
- Amélioration des rendements : Des sols riches permettent une meilleure disponibilité des nutriments et une croissance végétale plus soutenue.
- Réduction des charges liées aux intrants : Moins d’engrais, moins de traitements phytosanitaires et une meilleure santé des cultures permettent des économies substantielles.
- Accès à des financements ou marchés carbone : Certains projets agro-environnementaux, labels bas carbone ou démarches RSE d’entreprises proposent une rémunération pour les efforts de stockage de carbone.
- Valorisation des produits agricoles : De plus en plus de consommateurs plébiscitent des produits issus d’un mode de production respectueux du climat. Cela ouvre des opportunités de différenciation sur le marché.
Quelques défis à relever pour pérenniser la séquestration du carbone
Malgré ses bénéfices, le stockage de carbone en agriculture nécessite un accompagnement technique, des indicateurs fiables et une démarche à long terme. Parmi les défis fréquemment cités :
- Mesure et suivi du carbone stocké : Les méthodes d’évaluation (bilans humiques, analyses de sol, modélisations) doivent être standardisées et accessibles.
- Variabilité selon les sols, les climats et les systèmes agricoles : Le potentiel de stockage diffère en fonction du contexte pédoclimatique et des pratiques mises en œuvre.
- Durabilité du stockage : Un changement de pratiques ou un retournement des parcelles peut libérer le carbone stocké précédemment. Il est donc essentiel d’inscrire les pratiques dans la durée.
- Manque de reconnaissance économique : Si des incitations commencent à apparaître, le prix du carbone reste encore trop bas pour constituer une véritable source de revenu complémentaire.
Une opportunité stratégique pour la transition agroécologique
Encourager le stockage de carbone dans les sols agricoles s’intègre pleinement dans une vision d’agriculture durable, axée sur la santé des sols, la résilience climatique, la sobriété en intrants et la valorisation des services écosystémiques.
Des initiatives comme le programme « 4 pour 1000 », lancé lors de la COP21, illustrent cette dynamique. Il s’agit d’augmenter annuellement de 0,4 % le stock de carbone des sols, ce qui, à l’échelle mondiale, permettrait de compenser une part importante des émissions anthropiques de CO2.
Les filières agricoles, les coopératives, les chambres d’Agriculture et les startups AgTech développent de plus en plus d’outils pour accompagner les producteurs dans cette démarche. Ainsi, la séquestration de carbone dans les sols ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité de co-bénéfices pour les agriculteurs et la planète.